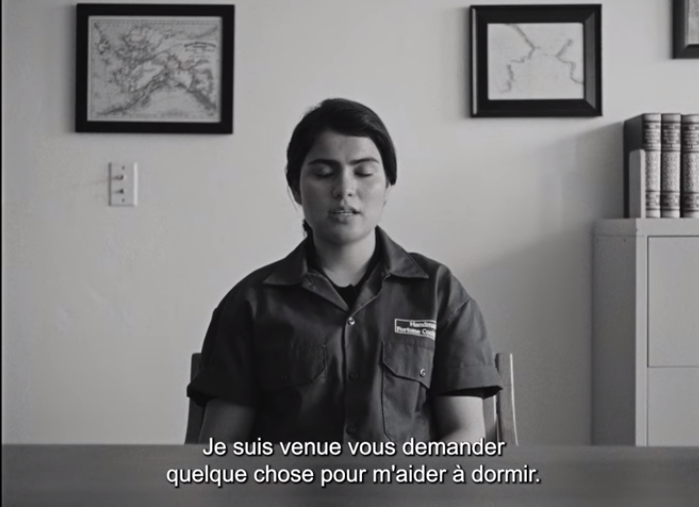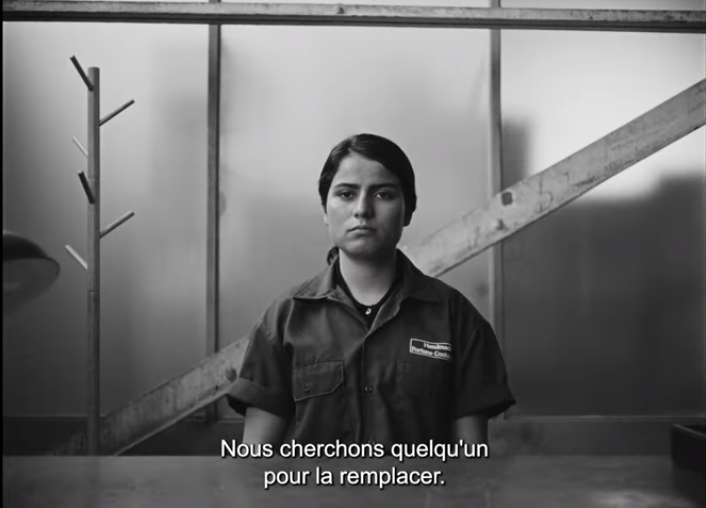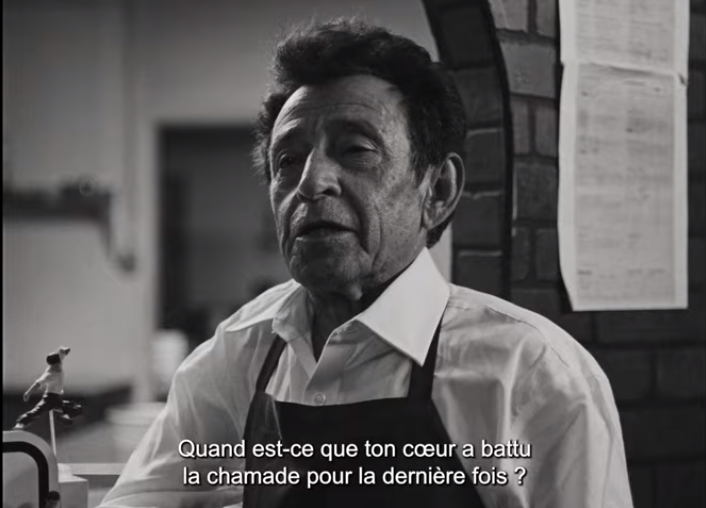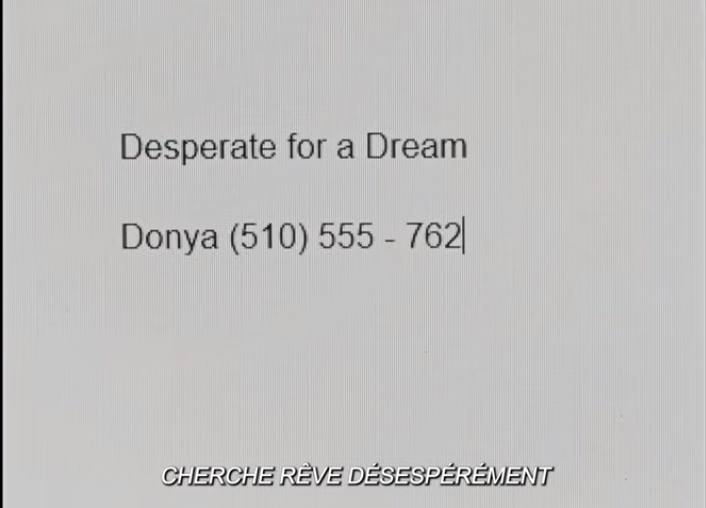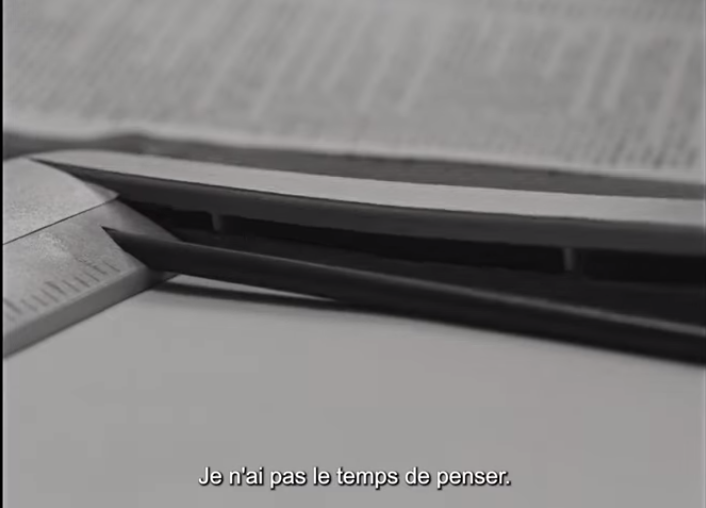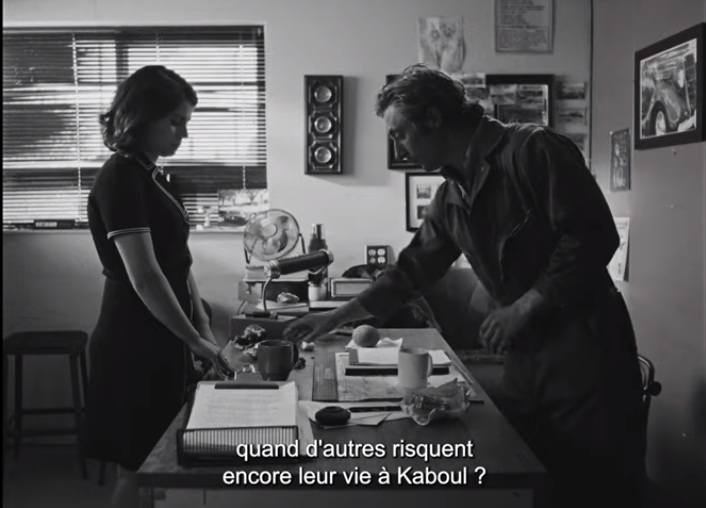une de mes connaissances que j’ai perdu de vue, mais croisé lors d’une manifestation contre la réforme des retraites, ne l’appelait que Constantinople. Il n’était pas question d’user d’un autre toponyme – ici, dans ce film titré Crossing Istanbul tout commence de l’autre côté de la mer Noire – à l’est, c’est en Géorgie (à la vitesse de ces jours-ci on y tue et on y inflige des coups, tous les soirs, tous les soirs: je me souviens de Constantinople, oui) – la ville de départ se nomme Batoumi et ça se présente comme ça

suggestif hein – ça ressemble un peu, ici vue de la côte asiatique (en amorce, à droite), à la ville d’arrivée

là européenne

à Istanbul, une des plus grandes et des plus belles villes du monde

et qui, dans ce film, tient la place d’un premier rôle – deux personnes, l’une assez âgée (elle a mon âge, t’as qu’à voir), Lia

l’autre, Achi, un jeune type assez sympathique

je recommence au début : Lia (Mzia Arabuli dans le rôle de la prof retraitée : magique) vient de subir un deuil : sa sœur vient de mourir, laquelle lui a fait promettre de retrouver sa propre fille, Tekla, disparue – en réalité Tekla a (peut-être) désiré changer de sexe et s’est enfuie depuis quelques années – Lia la recherche dans une espèce de banlieue de Bantoumi où vit Achi (Lucas Kankava) qu’un de ses frères tolère – on ne connait guère la fille que Lia recherche, elle vivait peut-être à côté « chez les trans »… Alors Lia s’en va

Achi lui court après : si lui il sait où se trouve la nièce de Lia, il ne voulait pas en parler devant son connard de frère parce que ces histoires de transsexuel.les… hein… mais c’est à Istanbul…

Lia ne le croit pas – il insiste – très bien, dit-elle, tu viens avec moi… Il n’y croit pas, mais si… et les voilà partis (en autobus) arrivent en Turquie (ça ne change pas grand chose…) puis à Istanbul – bateau 1

ils cherchent – bateau 2 – un épisode veut que Lia et Achi non encore devenus assez amis, soient invités à manger au restaurant par des Géorgiens

cet épisode devient une source de joie, alors on danse

mais la réalité revient : ils recherchent, cherchent Tekla sans la trouver – la réalité c’est qu’Achi a menti, il ne sait pas où se trouve la nièce de Lia –

ils cherchent – et puis encore

en ville – des péripéties certes, mais dans le même temps (ce cinéma-là est du beau cinéma, des histoires parallèles entremêlées, compréhensibles et sensibles, dans un même temps une même ambition, un même décor et un même affect) entre en scène Evrim (Deniz Dumanli, adorable) : elle est (assez récemment) devenue femme et avocate, notamment de transexuel.les

Evrim joue le rôle de la fée dans les contes (belle, compréhensive, dévouée, joyeuse et heureuse…) amicale

quelque chose de la belle vie – bon, évidement dans le contexte et l’univers (et notamment la société civile turque, machiste et bornée) dans lequel elle vit, c’est assez difficile – mais elle aidera Lia qui a des difficultés

qui ne retrouve pas sa nièce – Istanbul est trop grande trop étendue « je crois que c’est une ville où on vient pour disparaître » dit un dialogue – est-ce vrai ?

des péripéties : elle recontrera Evrim qui l’aidera

demandant à ses connaissances

permettant à Lia de rencontrer des « amies » de sa nièce

laquelle a disparu semble-t-il (ce n’est pas que ces « amies » soient souteneures, mais enfin qui peut savoir ? on le présume) – et Lia de chercher encore…

et puis et puis – des coups de cinéma (comme on dit des coups de théâtre) qu’on laissera découvrir – tenir ses promesses

je ne sais pas, mais en tout cas, pour le film, et pour le cinéma : c’est oui
Crossing Istanbul un film (suédois…) vraiment bien – réalisé par Levan Akin